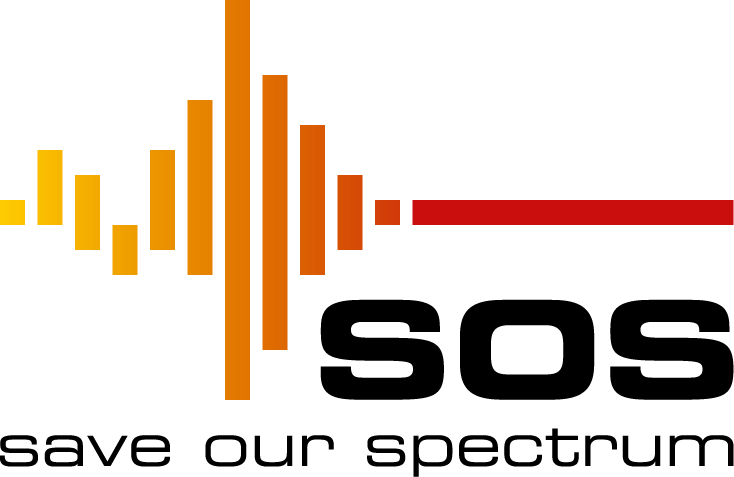Nos dirigeants politiques semblent aux prises avec un impératif irrésistible de transformer l’Union européenne – longtemps qualifiée de “projet de paix unique au monde” – en nouvelle alliance militaire. Cette volte-face induit une mutation existentielle qui échappe encore à la majorité des citoyens européens. L’heure est donc venue de tenter d’en saisir la portée et notamment, comme il sied à notre association “SOS – Save Our Spectrum”, sur le plan culturel.
L’armée allemande, ou Bundeswehr, a récemment multiplié ses incursions dans la bande 470-510 MHz pourtant allouée en priorité à la diffusion en DVB-T2 de la télévision numérique terrestre, tandis que les activités de programmation et d’événements spéciaux réunies sous le vocable de PMSE font, depuis des décennies, usage des espaces laissés ‘blancs’ entre les fréquences consacrées à la radiodiffusion pour le plus grand bonheur des fans de concerts publics et, plus généralement, de tous les amateurs de musique. Ces intrusions, conformes à l’autorisation publiée le 24 septembre 2025 dans la Gazette Officielle de l’Agence Fédérale des Réseaux, ont déjà un impact concret aux alentours des casernes de Pöcking, près de Munich. Les professionnels de l’événementiel de Haute Bavière, déjà particulièrement attentifs aux interférences en raison de la proximité de l’Autriche, doivent désormais considérer l’ensemble de la bande 470-510 MHz comme ‘à haut risque’. Des manifestations-phares telles que le Festival ‘Superbloom’ vont disparaître faute de disposer des fréquences compatibles avec 50% ou 75% des microphones qu’elles utilisent. La démonstration est ainsi faite, s’il en était besoin, que le mariage de la défense et de la culture relève des noces de la carpe et du lapin. Cette expropriation de sang-froid est d’autant plus difficile à comprendre que la Bundeswehr a le droit d’opérer dans une autre bande UHF, entre 694 et 790 MHz, mais n’en a jamais fait usage. Il serait sans doute plus conforme à la vérité de dire que cette expropriation effectuée dans la plus grande discrétion ne relève en rien d’une décision de sang-froid; elle s’inscrit plutôt dans le train de mesures parfois explosives engendrées par la panique qui a saisi l’Europe de l’Ouest alors que se précisent les perspectives d’une prochaine invasion russe. Il est à parier, dans ces conditions, que les citoyens allemands accepteront que la menace qui pèse sur la sécurité de leur pays prenne le pas sur la santé, l’éducation et autres préoccupations de bien-être en société, ainsi reléguées au rang de moindres priorités.
Il est permis de penser que le schéma qui vaut pour l’Allemagne, dans son diagnostic comme dans ses conclusions, ne va pas tarder à s’observer chez les autres membres européens de l’OTAN. Mais est-ce bien certain? La perception du Kremlin en tant que menace immédiate est différente entre les pays voisins de la Russie et ceux que bordent l’océan Atlantique, la mer du Nord ou, à plus forte raison, la mer Méditerranée. En outre, deux d’entre eux se sont dotés très tôt d’une force de dissuasion nucléaire alors que certains de leurs alliés sont trop petits pour disposer en permanence de forces armées conséquentes. En épousant un autre point de vue tout aussi légitime, la plupart des gouvernements européens prêtent une moindre attention à la culture ou au bien-être que, par exemple, la France, laquelle se distingue au fil des décennies par sa détermination à promouvoir la culture européenne autour du monde tout en inscrivant toutes sortes de dépenses de nature sociale au budget de l’Etat. Cette diversité quant aux choix de société fondamentaux constitue pour l’Union européenne une marque de fabrique dont elle tirait plutôt fierté jusqu’à présent, du moins en matière culturelle. Dans ces conditions, il n’est pas inutile d’essayer de cerner le point de vue que peuvent avoir les Français sur les changements radicaux qui animent une UE en proie à des évolutions inédites.
A moins que leurs gouvernements passés ou en place se soient montrés laxistes en matière de défense, les Français ont toutes les raisons de croire qu’une force de dissuasion nucléaire pleinement opérationnelle et totalement indépendante, conjuguée à des forces conventionnelles bien équipées et dûment entraînées, suffisent à assurer leur protection et l’intégrité de leur territoire. S’il en était autrement, les responsables demeurés insensibles aux bruits de bottes, voire à la guerre authentique que l’on déplore aux marches de l’Union auraient trahi la confiance dont ils étaient investis. De surcroît, la diplomatie française a longtemps été réputée l’une des plus efficaces du monde: le moment semble venu de l’inviter à déployer ses prouesses en reprenant langue avec les gouvernements qui se montrent hostiles; s’il n’apportait pas nécessairement la paix, un tel dialogue pourrait au moins éviter que la situation ne se dégrade plus avant. Il n’est pas innocent de noter à ce propos que les grandes puissances nucléaires ont pris soin de se doter d’une ligne ‘rouge’ directe entre elles, au plus haut niveau, en vue d’éviter au monde entier une Apocalypse née d’accidents ou de malentendus éventuels. L’appartenance de la France à ce club exclusif a coûté cher. Les contribuables français ont été lourdement sollicités, dans les années soixante, pour financer ce qui s’appelait alors la “force de frappe”, c’est-à-dire un arsenal nucléaire indépendant et suffisant pour assurer une dissuasion effective. Pendant ce temps, le reste de l’Europe continentale se contentait d’un “parapluie américain” alors jugé moins coûteux et plus pratique. La contribution de leurs aïeux devrait dispenser les contribuables français d’aujourd’hui de la double peine qui consisterait à épouser étroitement l’attitude de partenaires européens que leurs prévisions peut-être trop optimistes contraignent à un rattrapage douloureux. Tant il paraît juste que la solidarité ne vienne pas forcer ceux qui ont résolu leur équation géopolitique en temps utile à communier au mouvement de panique qui frappe ceux qui pourraient avoir manqué de prévoyance. Ce raisonnement s’applique aux fréquences, ressource encore plus rare que l’argent des contribuables. Au nom de quel impératif stratégique ou tactique l’armée française devrait-elle s’aventurer au sein des fréquences réservées à la culture? Au cas où les Français seraient consultés sur un éventuel dilemme entre l’allocation du spectre disponible aux fins de faciliter la création et la diffusion de la culture ou bien à celles de défendre la patrie, il est probable qu’une majorité se dégagerait en faveur de la seconde option. Pourtant, un strict devoir de démocratie voudrait que la question leur soit posée explicitement de sorte que les amateurs de musique comprennent qu’il va à l’encontre du patriotisme le plus élémentaire de se livrer à leur loisir favori pendant que nombre de leurs compatriotes s’efforcent de bouter les envahisseurs hors des frontières.
Le dilemme entre guerre et culture fait plus que jamais figure de choix existentiel. En dépit de ses surnoms chèrement gagnés de “Père la Victoire” ou “Le Tigre”, Georges Clemenceau s’exclamait: “La guerre! C’est une chose trop grave pour la confier à des militaires.” Le peuple aurait-il dès lors voix au chapitre? L’avenir le dira. La seule certitude aujourd’hui est que “Si nous devions sacrifier la culture, Poutine aurait déjà gagné”, comme l’exprime si justement Jochen Zenthöfer, au nom de “SOS – Save Our Spectrum”.